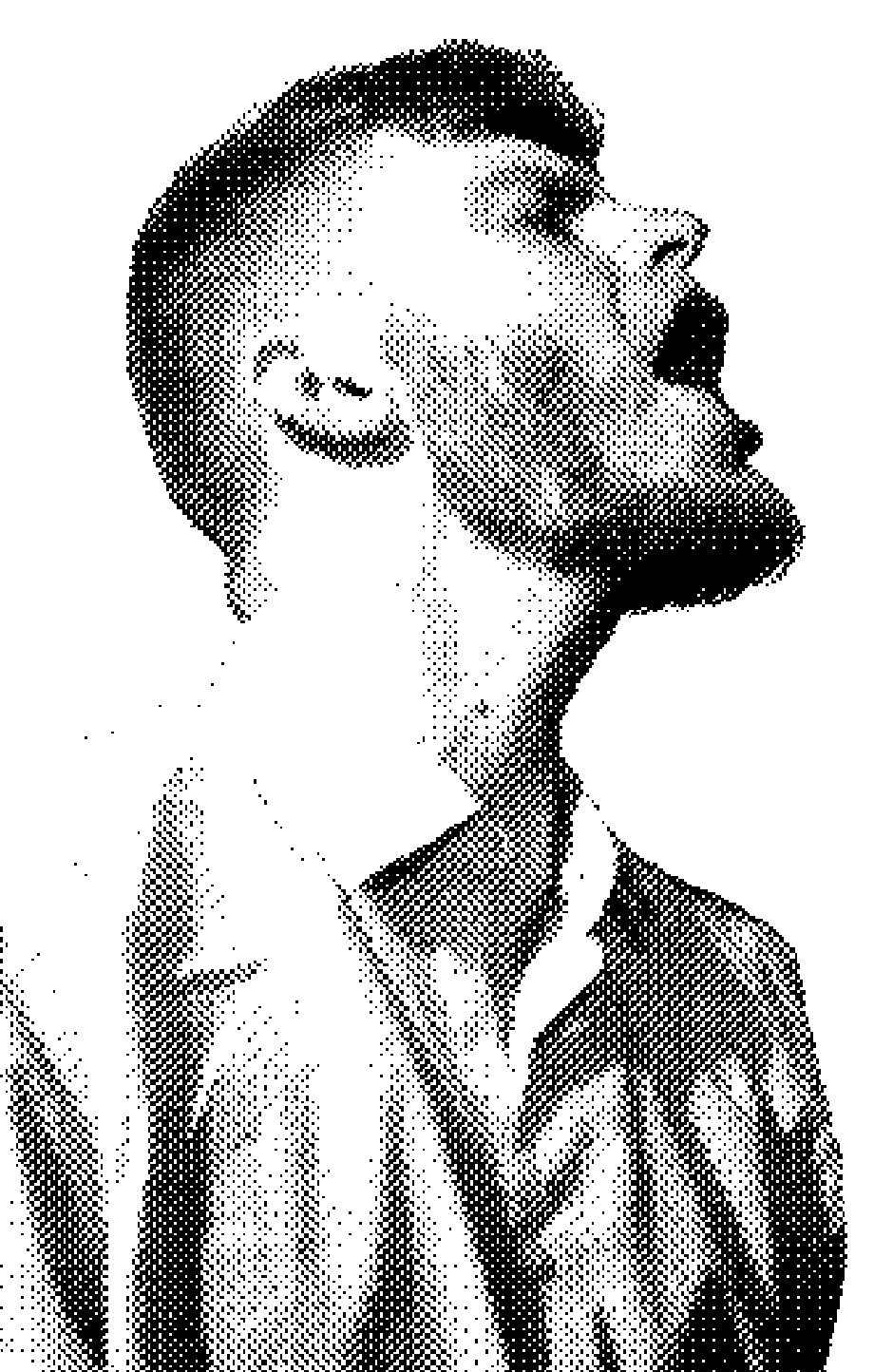Que nous apprend le chant alsacien sur l'histoire de l'Alsace ? Entretien avec Daniel Muringer

Daniel Muringer est un acteur majeur du chant alsacien de ces dernières décennies. Collecteur, compositeur, interprète avec le groupe “Géranium”, il a notamment collecté un millier de chants, qu’il a généreusement offert à notre travail. Il répond à une série de questions de notre part, pour faire un état des lieux et des perspectives possibles pour un trésor culturel bien mal en point.
Que nous disent les chants alsaciens de la particularité de cette région, ballotée entre l’Allemagne et la France depuis le début des collectages ?
Daniel Muringer : Tout d'abord que la langue historique de la région est l'allemand ! La très grande majorité des chants collectée sont en effet en allemand "standard", ceux en allemand dialectal (en "alsacien", soit alémanique ou francique en Moselle) sont bien moins nombreux. Ce qui rattache la région au domaine culturel germanique.
En particulier, est-ce qu’il y a une plus grande dimension politique, anti-militariste, ou simplement plus de chants en rapport avec l’Histoire que dans les répertoires populaires d’autres régions ?
Daniel Muringer : Je ne me risquerai pas à dire qu'il y a plus de chants en rapport avec l'histoire dans le corpus chansonnier traditionnel alsacien. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a, surtout à partir de la Révolution et du Premier Empire.
Deux très anciens, aussi : celle qui raconte la condamnation du bailli Peter von Hagenbach, en 1474, au service de Charles le Téméraire qui détient un temps la Haute-Alsace, sur un choral du XIIè siècle ("Christ ist erstanden"), un autre qui évoque l'intervention des cantons suisses volant au secours de son alliée, la République de Mulhouse, en 1468 ("Woluf mit richem Schalle").
Parmi les douze chansons recueillies par Goethe, plus d'une dénonce la cruauté, voire l'immoralité des nobles, et ont en cela une forte tonalité anti-aristocratique.
Le célèbre poète allemand Goethe était aussi un des premiers collecteurs de chants populaires alsaciens.
Napoléon 1er a visiblement eu du succès dans la région (c'est l'Empire qui consolide, aux yeux de certains, les gains de la Révolution, dont les acquisitions de biens nationaux qui ont été importants dans une région où l'Église de l'Ancien Régime disposait de nombreuses terres (Évêché de Bâle et de Strasbourg, prince-abbé de Murbach, ...). La présence de nombreux protestants et de juifs, émancipés par la Révolution, peut avoir joué un rôle dans l'engouement : la moitié des ressortissants de ces deux communautés dans l'ensemble du royaume vivent en Alsace. Le culte de Napoléon trouve son paroxysme dans le chant "Gott der Herr hat auch ein Sohn" ("und der heißt Napoleon", coll. Weckerlin : "Dieu le père a aussi un fils, et il s'appelle Napoléon"...)
La question sociale est quasiment absente : une complainte de paysans du 16è siècle que Weckerlin relie à la Guerre des Paysans de 1525 ("Bauernkrieg"). L'évocation de la misère ouvrière du XIXè quasi-nulle.
La guerre de Crimée a laissé plusieurs traces en chansons, et bien évidemment, les chansons de soldats, qu'ils partent ou qu'ils s'en reviennent de guerre, ne manquent pas : "O Strassburg, O Strassburg" (coll. Weckerlin) a, pour sa part, un indéniable contenu anti-militariste.
https://open.spotify.com/track/5U9IXLr8tHe3DorOufWuhW?si=c659dd6e8160483a
On m'a transmis des paroles sur l'air de "sous les ponts de Paris" de Vincent Scotto, qui se moquent de l'empereur Guillaume, écrit après la Première Guerre mondiale et chantées dans des fêtes de famille jusque dans les années 60. Richard Schneider a noté, pour sa part, un courte chanson sur l'air de "Lili Marlene" qui, sans le citer, évoque les déboires de Hitler en Russie.
Le collectage a-t-il livré tous ses secrets concernant cette question ? Quels autres éléments sont à prendre en compte pour comprendre ce que les chants nous disent de l'histoire de l'Alsace ?
Daniel Muringer : Une réserve s'impose ici toutefois : on ne sait pas ce que les collecteurs n'ont pas pu entendre, ou ont laissé de côté : je pense à nouveau aux chants ouvriers qui n'ont pas pu manquer dans la région, notamment dans le Haut-Rhin, qui a connu la plus forte exploitation ouvrière de l'hexagone, comme l'indique le rapport du docteur Villermé.
Il faut évoquer encore les enjeux géo-politiques liés au choix de langue selon les publications et leurs dates. Il n'est ainsi pas fortuit que le collectage Weckerlin, publié en 1883 en France, soit plus de dix ans après l'annexion prussienne de 1871, contient particulièrement de nombreux chants en dialecte, ce qui participe de "l'invention" d'une Alsace différente de l'Allemagne, une nécessité pour le revanchisme français d'alors.
Après 1918, et surtout après 1945, apparaissent des traductions en français des paroles originales en alsacien ("Das Elsàss unser Landl" devenant "que notre Alsace est belle"), souvent pour chœurs. François Wilhelm se livrera à cet exercice dans son collectage de 1947 : le texte original y perdra toute sa saveur, doublé (et parfois remplacé dans d'autres recueils) par une langue trop précieuse et ampoulée pour prétendre se substituer à une expression populaire.
On mentionnera aussi les déboires du collectage de Joseph Lefftz, prêt à paraître en 1939, mais mis au pilori par les Allemands parce que contenant l'un ou l'autre chant en français ou trop républicain et patriotique au goût des nazis. En miroir, après la libération, l'ouvrage devra attendre 1966 pour être édité, l'administration française refusant sa parution en raison de l'omni-présence dans le livre de l'allemand, langue officiellement interdite en Alsace après-guerre jusque dans les années 50.
La langue des chansons revêt ici une dimension idéologique, liée abusivement à des considérations de souveraineté territoriale.
Réponses recueillies par GB