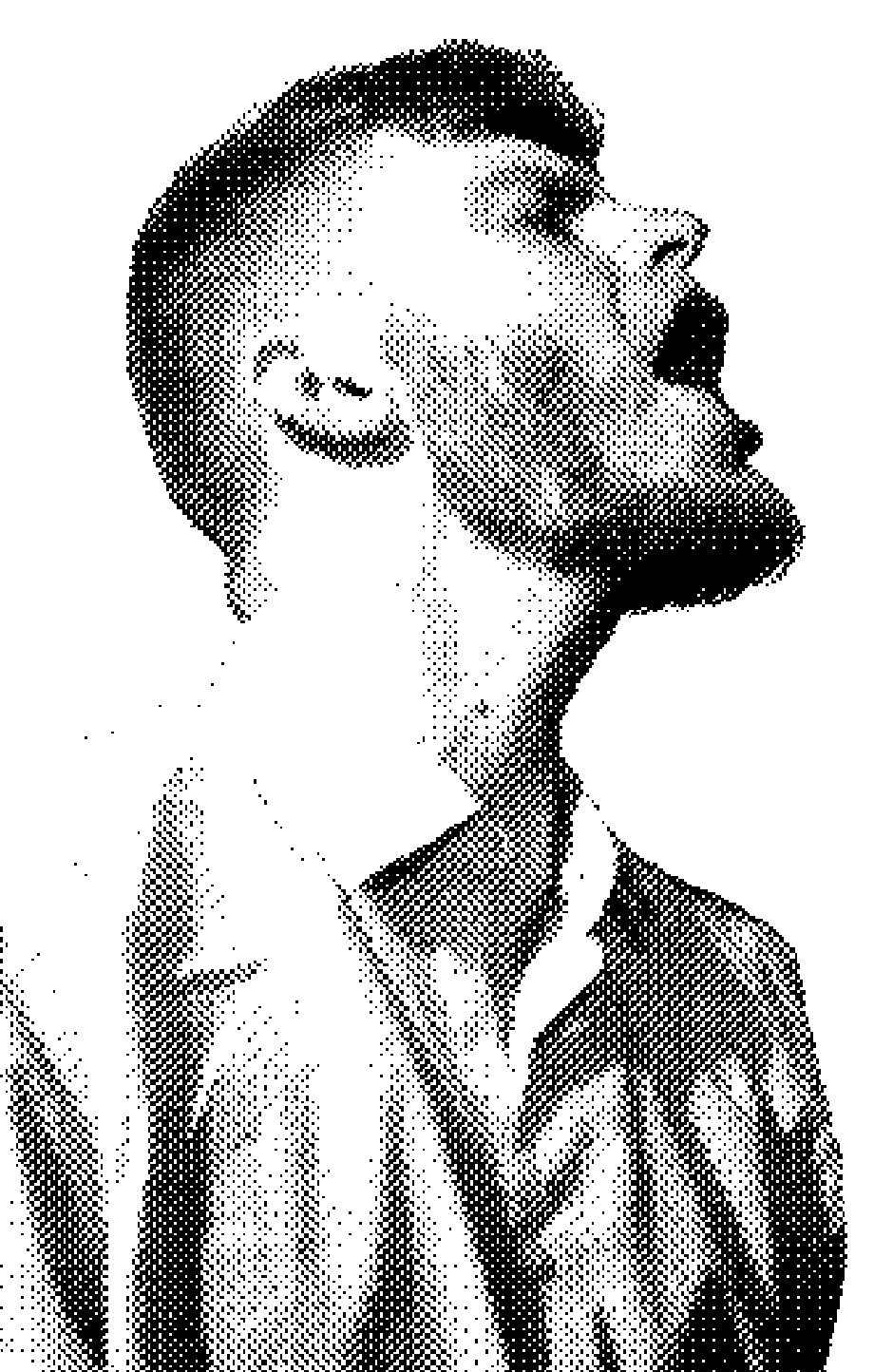Top 5 des chants populaires issus de l’Histoire de France
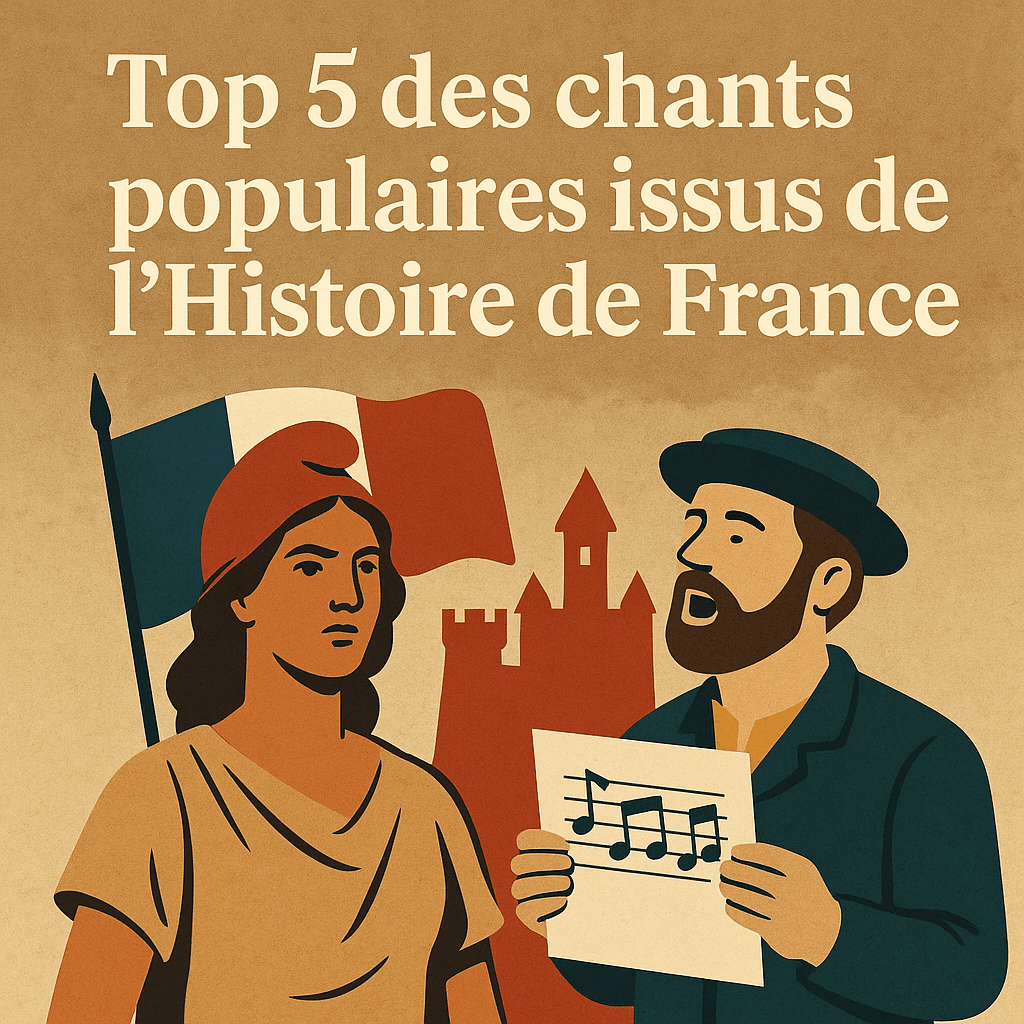
Les chants populaires ne sont pas figés dans le temps. Ils naissent et se transforment au gré du contexte historique, de leur utilisation, des langues locales... Et parfois, ils surgissent de l’Histoire, portés par un événement marquant, un personnage célèbre, ou une émotion collective si forte qu’elle trouve refuge dans une mélodie. C’est dans ces instants de bascule que la chanson devient bien plus qu’un divertissement : elle devient mémoire.
Le Chant du Départ : un chant révolutionnaire devenu hymne impérial
En 1794, alors que la France révolutionnaire affronte des coalitions extérieures et cherche à affirmer ses idéaux. Quoi de mieux alors qu’un chant pour fédérer autour de ce nouveau Régime ?
Le Comité de salut public commande un chant destiné à enflammer les esprits. Marie-Joseph Chénier, poète patriote, écrit les paroles ; Étienne Méhul, compositeur très réputé à l’époque pour ses opéras, compose la musique. C’est ainsi que naît Le Chant du Départ, un hymne vibrant, construit en sept couplets, chacun incarné par une figure de la société révolutionnaire (la mère, le vieillard, le guerrier, etc.).
Dès sa première exécution le 14 juillet 1794, il s’impose comme un symbole puissant. Il devient rapidement un chant militaire, et Napoléon Bonaparte le considère comme supérieur à La Marseillaise, au point de le choisir comme hymne de l’Empire. Dans les décennies suivantes, il réapparaît lors de grands conflits (1870, 1914–1918, 1939–1945) et se glisse jusque dans la culture populaire, notamment dans le film La Guerre des Boutons. Plus récemment, certains hommes politiques l’ont utilisé en campagne, comme Valéry Giscard d’Estaing ou Jean-Luc Mélenchon, pour invoquer une certaine grandeur républicaine.
Aujourd’hui encore, ce chant militaire français est interprété lors de cérémonies patriotiques. Il incarne l’engagement, la volonté collective et l’idéal révolutionnaire.
Au 31 du mois d’août : un chant de marin français aux racines historiques
Au 31 du mois d’août est sans doute l’un des chants de marin traditionnels les plus emblématiques du répertoire français, encore largement entonné aujourd’hui bien au-delà du seul univers maritime.
Il relate un événement glorieux : la prise du navire britannique Kent par le corsaire Robert Surcouf, au large des côtes indiennes, en octobre 1800. La chanson situe cependant l’action au 31 août et à Bordeaux, preuve que le peuple s’approprie l’histoire pour en faire un récit chanté, transmissible et facilement mémorisable.
Ce n’est pas un hasard si ce fait d’armes devient une chanson. Surcouf est un personnage fascinant : capitaine redouté, mais aussi commerçant et stratège, il incarne une forme d’héroïsme populaire, rusé et audacieux. Il est le corsaire à la française comme on l’aime, le justicier des mers un brin frondeur et profondément libre.
Le chant se développe dans les années qui suivent, d’abord parmi les marins, puis dans les cafés et les fêtes populaires. Il est repris par des chorales, adapté dans des versions festives, parfois grivoises, devenant aussi une chanson paillarde.
Aujourd’hui, des groupes comme Les Marins d’Iroise ou Le Bagad de Lann-Bihoué le remettent régulièrement au goût du jour. C’est un chant de marin idéal pour illustrer la fierté nationale et l’esprit de camaraderie des équipages. Mais il dépasse largement le cadre maritime : entonné à pleine voix lors de banquets, de veillées ou de retrouvailles entre amis, il devient un chant festif et rassembleur, capable de faire vibrer n’importe quelle tablée autour d’un bon verre et d’un refrain repris en chœur.
--> Paroles - Au 31 du mois d'Août
La Complainte de Mandrin : chant populaire et protestataire
Après le 31 du mois d’août du corsaire Surcouf, voici la chanson du pirate de la terre ferme : Louis Mandrin (1725–1755). Il fut contrebandier, meneur de rébellion et figure populaire bien avant l’essor des médias modernes. À la tête de plusieurs dizaines, parfois centaines d’hommes, il menait des opérations spectaculaires contre la Ferme Générale, cette institution privée chargée de percevoir les impôts, honnie par la population.
C’est dans les années qui suivent sa mort que naît La Complainte de Mandrin. Elle est d’abord diffusée par colporteurs sous forme de feuillets, puis transmise oralement dans les campagnes du Dauphiné, d’Auvergne ou du Vivarais. Le chant transforme le hors-la-loi en héros justicier. L’air proviendrait d’un opéra-comique du XVIIIe siècle, ce qui témoigne d’un métissage entre musique savante et culture populaire.
Plusieurs versions circulent : certaines racontent sa capture, d’autres sa mort, d’autres encore ses triomphes. Elle devient dans les années 1870 un chant protestataire repris par les Communards, puis au XXe siècle, elle est chantée par Monique Morelli, Julien Clerc ou encore Dorothée. On la retrouve aussi dans certains recueils de comptines pour enfants, preuve de sa diffusion étendue.
--> Paroles - La complainte de Mandrin
Nous n’irons plus au bois : la comptine aux doubles sens
Nous n’irons plus au bois est l’illustration parfaite de la comptine pour enfants à double lecture. Souvent perçue aujourd’hui comme une simple chanson de ronde, elle trouve son origine en 1753. On l’attribue à Madame de Pompadour, favorite de Louis XV, qui l’aurait fait composer pour marquer la fermeture des maisons de prostitution situées dans les bois de Boulogne. Les “lauriers” que l’on y “coupait” sont une allusion transparente aux activités qui s’y déroulaient.
Avec le temps, la signification s’efface, la mélodie reste. La chanson devient une ritournelle apprise à l’école, chantée dans les cours de récréation. Elle est utilisée par la radio publique française (ORTF) pour signaler les débuts et fins d’émissions. Claude Debussy la cite dans ses œuvres, tout comme Jacques Brel ou Chantal Akerman dans leurs créations respectives.
Sous son apparente innocence, cette comptine enfantine continue de fasciner par sa richesse symbolique et son histoire singulière. Gageons que la prochaine institutrice qui l’enseignera à ses élèves ne l’entendra plus tout à fait de la même oreille.
--> Paroles - Nous n'irons plus au bois
C’était Anne de Bretagne : chanson régionale et politique
Le 6 décembre 1491, Anne de Bretagne épouse Charles VIII, roi de France. Cette union met fin à l’indépendance du duché de Bretagne après un siège de Rennes et d’intenses tractations diplomatiques. La chanson C’était Anne de Bretagne raconte cet épisode sous une forme poétique : on y évoque la duchesse en sabots, le pied de verveine, la promesse de royauté.
Ce chant, transmis oralement, conserve l’émotion d’un rattachement politique vécu comme une perte par certains, une alliance par d’autres.
À la fin du XIXe siècle, ses couplets inspirent une autre chanson célèbre : En passant par la Lorraine, promue par la Troisième République pour nourrir le patriotisme scolaire après la perte de l’Alsace-Moselle. Le mot “Lorraine” suffisait à rappeler la blessure nationale.
C’était Anne de Bretagne est un exemple remarquable de chanson régionale bretonne, dont la symbolique continue d’évoquer la question de l’identité et de l’union politique. Elle fait également partie du répertoire scout et folklorique.
--> Paroles - C'était Anne de Bretagne
Conclusion : la mémoire en musique
Ces chansons issues de l’Histoire de France, qu’elles soient chansons révolutionnaires, chants militaires, comptines pour enfants ou chants de marins, racontent l’Histoire à leur manière. Ou plutôt, à travers elles les Hommes du passé nous transmettent un peu de leur vie de l’époque. Certes, elles enjolivent parfois les faits, simplifient ou exagèrent, mais elles ne trahissent jamais l’émotion. Elles sont la voix d’un peuple qui observe, qui commente, qui transmet.
À travers elles, ce ne sont pas seulement des mélodies qui survivent, mais des pans entiers de notre mémoire collective. Ces chants sont des outils, des témoignages, des moyens d’expression. Ils nous relient aux siècles passés et nous rappellent que l’Histoire, avant d’être écrite, a souvent été chantée.
A nous faire vivre ce patrimoine…retrouvez tous ces chants sur Chantsdefrance.fr !